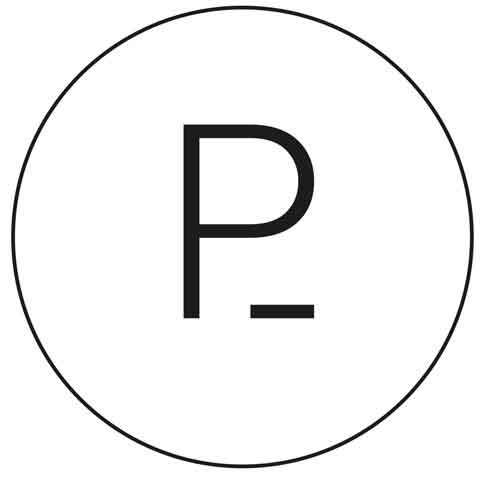L’industrie de la mode a connu une évolution spectaculaire au cours des dernières décennies. En seulement quelques années, la production de vêtements artisanale et locale est devenu une industrie dominée par la fast fashion. Cette transformation a rendu les vêtements à la mode plus accessibles que jamais, mais à quel prix ? Derrière les rayons bien achalandés se cachent des réalités complexes. Les conditions de travail sont souvent précaires et les usines ont des impacts environnementaux dévastateurs. Découvrez les événements et les dynamiques économiques qui ont façonné l’industrie de la production de vêtement.
La rencontre historique qui a tout changé
En 1972, une rencontre historique a bouleversé les structures diplomatiques mondiales et a ouvert la voie à une transformation massive de l’industrie du vêtement.
Cette année-là, Richard Nixon, alors président des États-Unis, et Mao Zédong, dirigeant de la Chine populaire, se sont rencontrés. Cette rencontre a marqué le début de l’ouverture de la Chine au reste du monde, après plusieurs siècles d’isolement. Progressivement, les barrières commerciales ont été levées, ouvrant de nouvelles opportunités pour les industries du monde entier. Un marché immense et jusque-là inconnu s’est ouvert, échappant à toute réglementation stricte.
Les débuts de la délocalisation de la de la production de vêtements
Avant cette période, les grands noms de la mode avaient leurs propres ateliers de production. Ils travaillaient en étroite collaboration avec des usines et des fabricants bien identifiés. Il y avait alors un fort sentiment d’appartenance à une communauté, une protection assurée de leur propriété intellectuelle et des règles de marketing adaptées (origine, fabrication et prix des produits).
La délocalisation de la production de vêtements est un phénomène qui a radicalement transformé l’industrie de la mode au cours des dernières décennies. Cette stratégie économique, adoptée massivement par les grandes marques de mode, consiste à déplacer les activités de production vers des pays où les coûts de main-d’œuvre sont nettement inférieurs. Cette section explore les raisons de cette délocalisation, ses conséquences, et présente des chiffres clés pour mieux comprendre son ampleur.
Les raisons de la délocalisation de la production de vêtements
Les principales motivations derrière la délocalisation sont économiques. En transférant leur production vers des pays à bas salaires, les entreprises de mode peuvent réduire considérablement leurs coûts de production. En 2020, le coût moyen de la main-d’œuvre dans les pays développés comme les États-Unis était d’environ 23 dollars de l’heure, contre moins de 2 dollars de l’heure en Chine et encore moins dans des pays comme le Bangladesh, où le salaire minimum est d’environ 0,30 dollar de l’heure .
Outre les bas salaires, ces pays offrent également des réglementations environnementales et de travail moins strictes, permettant aux entreprises de réduire leurs coûts d’exploitation. La Chine, par exemple, est devenue l’atelier du monde grâce à ses politiques favorables aux entreprises étrangères et à ses vastes ressources humaines. En 2021, la Chine représentait environ 32% de la production mondiale de textiles et de vêtements .
Les chiffres de la délocalisation
La délocalisation de la production de vêtements a des répercussions massives sur l’économie mondiale. En 2019, les exportations mondiales de vêtements étaient évaluées à plus de 500 milliards de dollars . La Chine, le Bangladesh, le Vietnam et l’Inde sont parmi les principaux bénéficiaires de cette tendance. À eux seuls, ces pays représentaient environ 60% des exportations mondiales de vêtements en 2020 .
Le Bangladesh, en particulier, a vu son industrie du vêtement exploser, devenant le deuxième plus grand exportateur de vêtements au monde après la Chine. En 2020, les exportations de vêtements du Bangladesh ont atteint environ 34 milliards de dollars, représentant plus de 80% des recettes d’exportation du pays .
Conséquences sociales et environnementales de la délocalisation
Si la délocalisation a permis de réduire les coûts pour les entreprises et les consommateurs, elle a également entraîné des conséquences sociales et environnementales préoccupantes. Les conditions de travail dans les usines de vêtements des pays en développement sont souvent précaires, avec des heures de travail excessives, des salaires insuffisants et un manque de mesures de sécurité. La tragédie du Rana Plaza en 2013, où l’effondrement d’une usine de vêtements au Bangladesh a causé la mort de plus de 1 100 travailleurs, a mis en lumière ces conditions déplorables .
Sur le plan environnemental, la délocalisation de la production a contribué à la pollution et à la dégradation des ressources naturelles. La production textile est l’une des industries les plus polluantes au monde, responsable de 10% des émissions mondiales de carbone et de 20% des eaux usées industrielles .
L’évolution des compétences et l’exploitation
Rapidement, les ouvriers chinois sont devenus de plus en plus compétents. Les industriels ont compris qu’exploiter une main-d’œuvre non syndiquée et n’être soumis à aucune règle en termes de protection environnementale représentait des atouts considérables. Cela se traduisait par une hausse conséquente de leurs marges et de leurs profits. Dès la fin des années 1980 et tout au long des années 1990, une grande partie du savoir-faire technique, des outils et des machines de production qui s’étaient développés sur plus de deux cents ans ont été exportés vers la Chine. Parfois, cela se faisait du jour au lendemain.
La difficulté de protéger la propriété intellectuelle
Dans le secteur de la mode, il est très difficile de protéger la propriété intellectuelle. Les industriels ont donc commencé à copier des vêtements dessinés par des stylistes et à proposer ces nouveaux produits aux consommateurs. Nous en avons redemandé, et c’était bien là le but recherché. Aurions-nous choisi des copies de créateurs bon marché à des prix ridiculement bas si nous avions eu les moyens d’acheter de vrais vêtements de créateurs à des prix plus abordables ?
L’objectif de la production de masse
L’objectif de la production en série était de générer – et non plus seulement d’alimenter – une consommation de masse et de la rendre ostentatoire. Nous ne sommes pas programmés pour acheter ou stocker des vêtements en grande quantité, mais nous le faisons cependant, influencés par les stratégies de marketing et les tendances de la fast fashion. Contrairement à ce que nous pensons, les vêtements n’ont pas perdu de leur valeur. Bien sûr, ils sont moins chers et sont confectionnés avec moins de soin, mais c’est le regard que nous portons sur eux qui fait leur vraie valeur.
Le besoin d’une économie équitable
En vérité, nous avons besoin de vêtements bon marché, élégants et à la mode, destinés à ceux qui n’ont pas les moyens de dépenser des fortunes pour s’habiller. Nous avons besoin d’une économie qui permet à toute la population de se vêtir à un prix décent, mais qui n’humilie et ne déshumanise pas les travailleurs qui confectionnent les vêtements. Les marques doivent s’assurer que les vêtements bon marché sont fabriqués par des ouvriers protégés par des syndicats, des hommes et des femmes qui perçoivent un salaire décent afin de confectionner des vêtements avec des matériaux ayant un effet régénérateur sur notre environnement, et non pas simplement épuiser nos ressources.
La responsabilité des marques
Les marques ont une responsabilité énorme dans cette équation. Elles doivent veiller à ce que les conditions de travail soient justes et sûres, et que les matériaux utilisés pour la confection des vêtements soient durables et respectueux de l’environnement. C’est leur responsabilité de s’assurer que les vêtements qu’elles produisent ne nuisent pas aux travailleurs ni à la planète.
Notre responsabilité en tant que consommateurs
À l’autre bout de la chaîne, c’est notre responsabilité, à nous consommateurs, de prendre soin des choses que nous possédons une fois qu’elles sont entre nos mains. C’est à nous de prendre les décisions qui s’imposent à chaque étape de notre parcours de propriété, du moment où naît en nous le désir d’acquérir un vêtement, à celui où nous l’achetons, jusqu’au moment où nous nous en débarrassons. Nous devons agir de manière responsable.
La fast fashion c’est un peu comme une rencontre d’un soir.
C’est une rencontre qui ne laisse pas la place aux sentiments. La fast fashion se caractérise par une production rapide, des prix bas et une obsolescence programmée. Les consommateurs achètent souvent ces vêtements sur un coup de tête, séduits par des tendances éphémères et des promotions alléchantes. Cependant, comme une rencontre d’un soir, cette relation est superficielle et ne laisse pas de place aux sentiments durables. Les vêtements de fast fashion sont conçus pour être consommés rapidement et remplacés fréquemment. Ils manquent de la qualité et de la durabilité qui permettent de créer un attachement émotionnel. La satisfaction qu’ils procurent est instantanée mais fugace, laissant souvent un sentiment de vide une fois l’euphorie initiale dissipée.
Or, il est bon de poser un autre regard sur nos vêtements et d’instaurer une relation responsable.
Pour transformer notre relation avec la mode, il est crucial de passer à une approche plus réfléchie et durable. En valorisant des vêtements de qualité et en développant un lien émotionnel avec ce que nous portons, nous pouvons créer une garde-robe qui a du sens et qui respecte à la fois les travailleurs de l’industrie et notre planète.
Nous devons nous engager à les porter des années durant, même s’ils sont usés jusqu’à la trame. Il faut faire en sorte que le vêtement fait pour votre silhouette corresponde aussi à vos principes. Si un vêtement vous va et est en accord avec vos valeurs, alors achetez-le. Dans le cas contraire, marquez une pause et posez-vous les bonnes questions.
Une nouvelle ère de la mode responsable
Il est temps de repenser le modèle de l’industrie de la mode pour garantir un avenir plus juste et durable. En tant que consommateurs, nous avons le pouvoir de créer du changement. Il est important d’exiger plus de transparence et plus de normes plus élevées de la part des marques que nous soutenons. Il est crucial de soutenir des initiatives et des marques qui valorisent la transparence, l’éthique et la durabilité.
Se réapproprier la valeur des vêtements
L’industrie de la mode, particulièrement influencée par la fast fashion, a entraîné une perception erronée des vêtements comme des produits jetables. Ce mode de consommation, caractérisé par l’achat fréquent de vêtements bon marché, rapidement produits et tout aussi rapidement démodés, a de profondes répercussions sociales, économiques et environnementales. Il est crucial de repenser notre relation aux vêtements et de les considérer comme des biens de valeur durable plutôt que des articles éphémères.
Les vêtements ne doivent pas être perçus comme des produits jetables
L’industrie de la mode, particulièrement influencée par la fast fashion, a entraîné une perception erronée des vêtements comme des produits jetables. Ce mode de consommation, caractérisé par l’achat fréquent de vêtements bon marché, rapidement produits et tout aussi rapidement démodés, a de profondes répercussions sociales, économiques et environnementales. Il est crucial de repenser notre relation aux vêtements et de les considérer comme des biens de valeur durable plutôt que des articles éphémères.
Les conséquences de la perception des vêtements comme produits jetables
Impact environnemental : la production de vêtements à grande échelle consomme énormément de ressources.
Par exemple, la culture du coton, qui représente environ 24% des fibres textiles mondiales, nécessite d’importantes quantités d’eau et de pesticides.
En effet, la production d’un simple t-shirt en coton peut s’avérer incroyablement gourmande en eau. On estime qu’il faut entre 2 500 et 3 000 litres d’eau pour produire un t-shirt en coton.
Ce chiffre effarant s’explique par les différentes étapes nécessaires à la fabrication d’un t-shirt, de la culture du coton à la teinture et au finissage. La culture du coton est particulièrement demandante en eau. En effet, il faut en moyenne 10 000 litres d’eau pour produire un kilo de fibres de coton. Or, la production d’un t-shirt nécessite environ 250 grammes de coton. La transformation du coton en tissu n’est pas non plus sans impact. En effet, elle requiert également des quantités importantes d’eau pour le blanchiment, la teinture et le traitement des fibres.
Les fibres synthétiques, omniprésentes dans nos garde-robes, semblent à première vue offrir de nombreux avantages : résistance, durabilité, propriétés infroissables… Pourtant, leur production cache un revers sombre pour l’environnement.
Nées du pétrole, ces fibres, telles que le polyester, le nylon et l’acrylique, sont issues d’un processus industriel gourmand en ressources mais également polluant. L’extraction du pétrole, première étape de leur fabrication, est en elle-même une source majeure de dégâts environnementaux. Les forages détruisent des habitats naturels, fragilisent les sols et menacent aussi la biodiversité. Le transport et le raffinage du pétrole s’accompagnent quant à eux d’émissions de gaz à effet de serre, alimentant le réchauffement climatique.
La transformation du pétrole en fibres synthétiques n’est pas plus vertueuse.
Des cocktails de produits chimiques sont nécessaires afin de synthétiser les longues chaînes de molécules qui composent ces fibres. Ces produits chimiques,souvent toxiques, peuvent s’infiltrer dans les sols et les eaux, menaçant la santé des écosystèmes et des populations locales. La production de fibres synthétiques est également une activité particulièrement énergivore. Du forage à la transformation, chaque étape requiert des quantités importantes d’énergie, généralement issue de combustibles fossiles, ce qui accentue encore leur empreinte carbone.
Mais ce n’est pas tout. Les vêtements en fibres synthétiques ne sont pas biodégradables.
Ils s’accumulent dans les décharges et les océans, polluant durablement l’environnement. En outre, lorsqu’ils sont lavés, ils relâchent des microfibres, minuscules fragments de plastique qui contaminent l’eau et menacent la vie marine.
De plus, les teintures et traitements chimiques utilisés dans la fabrication des vêtements polluent les cours d’eau et les sols, entraînant des effets néfastes sur les écosystèmes et les communautés locales. Chaque année, environ 92 millions de tonnes de déchets textiles sont générés dans le monde, et une grande partie finit dans des décharges où ils peuvent prendre des centaines d’années à se décomposer, libérant des substances toxiques dans le sol et les nappes phréatiques. Par ailleurs, les microfibres synthétiques se détachent lors des lavages et contribuent à la pollution des océans.
Conséquences sociales
La perception des vêtements comme jetables contribue également à des conditions de travail précaires dans les pays en développement. Pour répondre à la demande incessante de nouveaux vêtements à bas prix, les usines de confection imposent des horaires de travail exténuants ainsi que des salaires très bas. Des employeurs exposent fréquemment des travailleurs, majoritairement des femmes, à des environnements de travail dangereux et insalubres. La tragédie du Rana Plaza a tragiquement illustré les conséquences de la fast fashion.
Valeur culturelle et personnelle des vêtements
Historiquement, on percevait les vêtements comme des objets de valeur. On les héritait et on les réparait au fil du temps. Cette approche contraste avec la mentalité actuelle de la mode rapide encouragés par des tendances changeantes et des prix bas. Considérer les vêtements comme des objets jetables dévalorise le travail de ceux qui les produisent. Cette perception empêche également les consommateurs d’apprécier la véritable valeur des vêtements.
Promouvoir une nouvelle approche des vêtements
Pour inverser cette tendance, il est essentiel d’adopter une approche plus consciente et durable de la mode :
- Favoriser la qualité sur la quantité
Investir dans des vêtements de qualité, conçus pour durer, peut réduire la nécessité de les remplacer fréquemment. Les consommateurs devraient privilégier des matériaux durables et des marques qui valorisent la qualité et la longévité de leurs produits. - Réparer et recycler
Encourager la réparation des vêtements endommagés et leur transformation créative peut prolonger leur durée de vie. De plus, le recyclage des textiles peut réduire la quantité de déchets envoyés aux décharges. Des initiatives comme les programmes de reprise de vêtements permettent de recyclés les vêtements usagés. - Adopter une mode circulaire
La mode circulaire, qui implique le partage, la location, l’achat d’occasion et le recyclage, minimise les déchets. Cette approche encourage les consommateurs à voir les vêtements davantage comme des investissements à long terme. - Sensibiliser et éduquer
La sensibilisation et l’éducation des consommateurs sur les impacts environnementaux et sociaux de la fast fashion sont cruciales. Des campagnes de sensibilisation aident à changer les mentalités et à promouvoir des choix de consommation plus responsables.
Reconsidérer notre perception des vêtements est essentiel pour un avenir plus durable et équitable.
En valorisant la qualité, en adoptant des pratiques de consommation responsable nous pouvons transformer l’industrie de la mode. Les vêtements ne sont pas des produits jetables. Ils sont des biens précieux qui méritent notre respect ainsi que notre soin. En changeant notre approche, nous pouvons contribuer à un monde où la mode est synonyme de durabilité et d’éthique.
Pour conclure, il est essentiel de se rappeler que chaque achat de vêtement a un impact. En optant pour des marques responsables et en prenant soin de nos vêtements, nous pouvons contribuer à un changement positif. C’est un petit pas vers un avenir où la mode sera non seulement belle, mais aussi éthique et durable. Faisons de la mode un vecteur de changement positif, pour nous-mêmes ainsi que pour les générations futures.
Fondatrice & Directrice artistique Voyageuse, curieuse, ses inspirations graphiques viennent du bout du monde ou du coin de la rue.