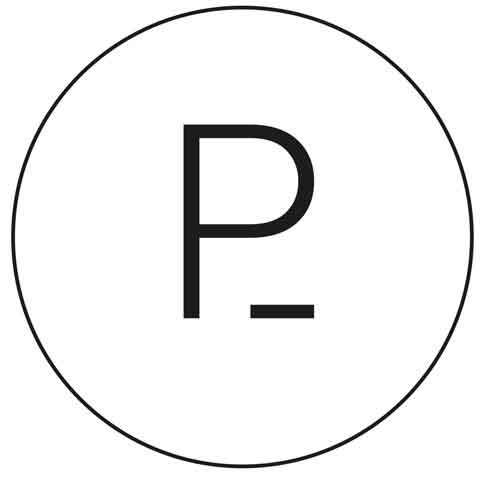À l’ère où l’information est à portée de main et où le militantisme en ligne prend de l’ampleur, il est difficile d’ignorer la nécessité de faire plus pour protéger notre planète. Les astuces et conseils écolos sont omniprésents, et chaque semaine, de nouvelles études nous rappellent les tonnes de gaz à effet de serre (GES) que nous émettons en mangeant tel ou tel aliment, ou la quantité d’eau gaspillée par des gestes quotidiens. Alors, que pourrait apporter de nouveau le journal d’une millénariale supposément engagée dans ce monde en crise? Probablement un peu de réalisme. Parce qu’on ne devient pas écoresponsable du jour au lendemain et surtout, parce que viser la perfection est une illusion.
Mon propre parcours vers la protection de notre planète ne s’est pas fait en un jour. C’est un chemin parsemé de petites étapes, d’erreurs, et de découvertes.
Enfant, j’étais terrifiée par les insectes et insistais pour porter des gants lorsque je jardinais avec ma mère. Étais-je donc une enfant urbaine complètement déconnectée de la nature? Un peu, mais pas tout à fait. Néanmoins, j’adorais passer mes après-midis en forêt, m’imaginant vivre à une autre époque, sans électricité. J’ai toujours rêvé de vivre dans un endroit avec un grand jardin, me voyant vivre dans les bois avec un minimum de possessions, dans un monde sans autoroutes ni gratte-ciel.
Comme beaucoup de milléniaux en quête de sens au début de leur vingtaine, je me suis mise à voyager seule vers des lieux exotiques. J’étais constamment à la recherche de nouvelles destinations, de hauteurs…. J’ai finalement compris que le meilleur moyen d’immortaliser un paysage et de rester ancrée dans le moment présent était de respirer profondément chaque parcelle du territoire. À cette époque, je ne faisais pas encore le lien entre mon admiration pour la nature et la nécessité de protéger nos ressources. Je voulais que les montagnes restent immaculées à jamais, sans me questionner sur la quantité de déchets que je générais en pique-niquant sur leurs sommets.
C’est autour de 2014 que j’ai vraiment commencé à m’intéresser à ces enjeux. En faisant mes recherches pour étoffer mes connaissances, j’ai commencé à appliquer certains principes écologiques dans mon quotidien. Par exemple, je faisais mon lait d’avoine et cuisinais des repas à partir de zéro. Cependant, au début de ma vingtaine, ma priorité restait de faire la fête. Petit à petit, j’ai commencé à prendre conscience de la crise climatique, à présenter des solutions pour minimiser son impact.
Mais ce n’est que lorsque mon copain et moi avons commencé à nous questionner sur notre futur lieu d’habitation que les contradictions ont émergé.
En 2019, nous avons déménager dans une coopérative d’habitation. C’est
un milieu de vie solidaire et rassembleur. Il comprenait des appartements pour familles, personnes seules et personnes âgées autonomes, ou en en légère perte d’autonomie. Nous vivions en plein centre-ville. Ainsi nous allons a pied au bureau, nous faisons la plupart de nos déplacements à pied. Néanmoins, notre amour pour les grands espaces nous faisait quitter très régulièrement cet environnement pour aller dans le bois.
Bref, on envisageait dans ce temps là, acheter un petit coin de terre genre un chalet pour nos week end. Comme beaucoup d’entre vous, j’ai longtemps rêvé d’un petit coin de paradis à la campagne. Un chalet douillet pour s’évader les week-ends, loin du tumulte de la ville. Plus je pensais à mon rêve de chalet à la campagne, plus je me questionnais.
C’est irresponsable de vivre dans deux endroits d’un point de vue écologique et social.
Acheter un chalet signifie vivre dans deux logements. Cela implique chauffer deux endroits, même si l’un reste vide une grande partie de l’année. Chauffer un chalet uniquement pour éviter que les canalisations ne gèlent ou pour maintenir un minimum de confort pendant les courtes visites, c’est une dépense énergétique considérable. En hiver, surtout, il est impossible de laisser un chalet sans chauffage, et cela a un impact direct sur notre empreinte carbone.
Au-delà de l’aspect écologique, il y a aussi des considérations sociales et économiques. Avoir un logement vide la moitié du temps ne contribue pas à la vie économique locale. Les petits commerces et services des zones rurales dépendent souvent des résidents permanents pour survivre. Un chalet occupé sporadiquement ne soutient pas ces entreprises de manière durable. Cela peut aussi contribuer à la hausse des prix de l’immobilier local, rendant l’accès à la propriété plus difficile pour les résidents à plein temps.
Mon rêve de chalet à mi-temps m’a amené à repenser mes priorités et mes choix de vie. Plutôt que de chercher une évasion ponctuelle, j’ai commencé à envisager de vivre à la campagne.
En parallèle, la pandémie a frappé. Nous avons découvert les joies du confinement et du télétravail. Vivre en plein centre-ville, sans pouvoir profiter des avantages qu’offre ce cadre de vie, c’est moins fun ! Cela perd tout son sens, quand il n’y a plus de boulot, plus de resto, plus de concerts, plus de sorties. Mais devoir néanmoins subir les désavantages du centre-ville : le bruit et la construction… Cela nous a un peu fait réfléchir à ce que nous souhaitons à l’heure actuelle.
La décision de partir vivre en campagne ne s’est pas fait en un jour.
Surtout qu’à l’époque, je n’avais même pas le permis de conduire… Aka l’indispensable pour vivre en milieu rural.
Mais comment être proche de la nature sans dépendre de l’automobile? Comment élever des enfants à la campagne sans se sentir coincée?
Je ne trouvais nulle part de témoignage de campagnards soucieux de leur empreinte environnementale.
Maintenant que je suis officiellement citoyenne du Haut Berry, je peux confirmer qu’il est possible de conjuguer un mode de vie sobre en émissions de GES et une maison unifamiliale à la campagne, malgré les défis et les sacrifices. Justement parce que je sais que l’adoption d’un mode de vie écoresponsable en campagne est complexe, j’ai voulu partager mes réflexions, mes réussites, mes échecs, et mes idées à tous ceux qui se questionnent sur leur futur milieu de vie et qui veulent respecter l’environnement.
Alors, c’est quoi ce blog au juste?
Je documente ma vie en adoptant les mêmes habitudes écoresponsables que j’avais développées en ville, mais en les transposant à la vie à la campagne. Dans un monde où l’écoresponsabilité est souvent associée à un garde-manger rempli de pots en verre et à un attirail de cuillères en bambou, j’ai essayé de dépasser ces clichés et de diminuer mon empreinte carbone dans chacun de mes gestes et choix.
À travers ce blog, je raconte les défis surmontables et insurmontables, les ratés, les victoires, les erreurs et toutes les réflexions qui en découlent, mais surtout les paradoxes.
Je suis consciente des privilèges que je possède, qui me permettent de vivre un mode de vie lucide et réfléchi, mais je suis aussi sensible aux réalités sociales, économiques et politiques de chacun. Chaque situation est différente, c’est vrai, mais je crois qu’il est toujours possible de faire mieux pour la planète quand on a la volonté de le faire.
Vivre de manière écoresponsable, surtout en campagne, n’est pas sans sacrifices.
C’est un équilibre constant entre confort personnel et impact environnemental. Par exemple, comment être proche de la nature sans dépendre de l’automobile? Vivre à la campagne implique souvent des trajets plus longs, parfois en voiture, ce qui va à l’encontre de la réduction des émissions de GES. Cependant, en choisissant judicieusement notre emplacement, en favorisant les transports en commun quand c’est possible, et en adoptant des modes de transport alternatifs comme le vélo, on peut réduire notre impact.
Un autre défi majeur est la gestion des déchets. En ville, le recyclage et le compostage sont souvent plus accessibles grâce à des infrastructures bien développées. En campagne, c’est parfois une autre histoire. Il faut souvent trouver des solutions locales, parfois créatives, pour réduire et gérer ses déchets. Par exemple, composter soi-même, recycler de manière responsable en emmenant ses déchets recyclables à des points de collecte spécifiques, ou même réduire à la source en évitant les produits sur-emballés.
Mais au-delà des gestes quotidiens, adopter un mode de vie écoresponsable c’est aussi changer de mentalité.
C’est accepter de vivre avec moins, de consommer différemment, de privilégier la qualité à la quantité. C’est aussi une remise en question constante de nos habitudes et de nos choix.
Parfois, il y a des échecs. Des moments où, malgré nos meilleures intentions, les choses ne se passent pas comme prévu. Par exemple, essayer de cultiver son propre potager et se rendre compte que la terre n’est pas aussi fertile qu’on le pensait, ou que les conditions climatiques sont plus difficiles à gérer qu’en ville. Mais ces échecs sont aussi des apprentissages. Ils nous poussent à nous adapter, à trouver des solutions, à persévérer.
Et puis, il y a les petites victoires. Réussir à réduire sa consommation d’eau, à diminuer ses déchets, à produire sa propre nourriture. Ces petites réussites nous encouragent à continuer, à aller plus loin, à partager nos expériences pour inspirer les autres.
En fin de compte, adopter un mode de vie écoresponsable, c’est un cheminement. Ce n’est jamais parfait, ce n’est jamais facile, mais c’est toujours gratifiant. C’est une manière de vivre en harmonie avec notre environnement et de respecter la nature.
Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, ni être un modèle parfait. Je suis encore en apprentissage, encore en quête de solutions. Mais je suis convaincue qu’ensemble, en partageant nos expériences, en apprenant les uns des autres, nous pouvons faire une différence. Chaque petit geste compte, chaque effort est important.
Alors, si vous êtes, comme moi, en quête d’un mode de vie plus écoresponsable, sachez que chaque pas compte. Les défis sont nombreux, mais les récompenses le sont aussi. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus vert, plus durable, pour nous et pour les générations futures.
Fondatrice & Directrice artistique Voyageuse, curieuse, ses inspirations graphiques viennent du bout du monde ou du coin de la rue.